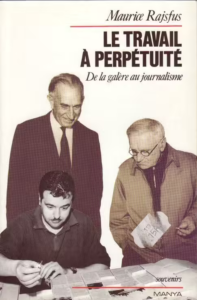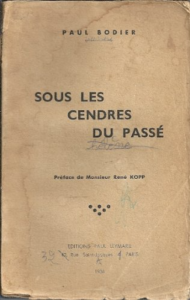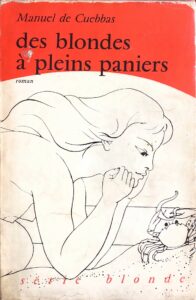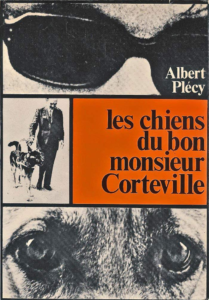L’histoire de la première édition, en 1924, du roman Le Bal du comte d’Orgel, de Raymond Radiguet, est révélatrice des limites que doit s’imposer le correcteur professionnel.
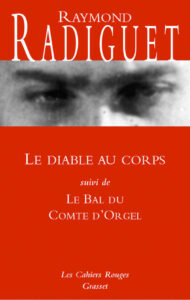
« Lorsque Raymond Radiguet meurt, le 12 décembre 1923, quelques mois après le lancement tonitruant du Diable au corps, il a remis à Bernard Grasset, depuis octobre, le manuscrit de son second roman, Le Bal du comte d’Orgel, un texte que l’éditeur juge suffisamment abouti pour en faire faire des épreuves fin octobre. Mais Raymond ne se met pas immédiatement à leur correction, et la fièvre typhoïde l’enlève brutalement. En hommage au jeune disparu, Grasset fait tirer 20 exemplaires numérotés de ces épreuves non corrigées pour les proches amis de Radiguet — dont Joseph Kessel, qui reçoit le numéro 1. Toutefois, le texte qui paraît en juin 1924 est fort différent de celui qui avait fait l’objet de ces “premières”. Non seulement ont été corrigées, légitimement, les “coquilles”, certaines lectures fautives du compositeur et quelques fautes de syntaxe, mais l’ensemble du texte a fait l’objet d’une “révision” qui excède de loin ce que se serait autorisé un bon correcteur. La comparaison des deux textes — épreuves et texte publié — montre que l’équivalent de 16 pages (sur 210) a été coupé, et que près de 600 modifications “stylistiques” ont été faites par Cocteau, Kessel et Pierre de Lacretelle. Car, comme l’écrit Georges Auric : “Avec les meilleures intentions du monde, quelques amis ont entrepris non pas la simple révision souhaitée mais, changeant des mots, modifiant des phrases, ont fini par s’abandonner à une véritable correction du roman, correction contre laquelle il me semble honnête de m’élever.”

« De fait, si les corrections opérées ne changent évidemment pas l’intrigue, elles modifient assez nettement la tonalité du Bal, dont elles font un exemple de classicisme là où Radiguet avait voulu un style “aristocratique un brin débraillé”, emblématique du nouveau “monde” qui émerge à la sortie de la guerre 14-18. Établie à partir des épreuves reçues par Kessel, la présente édition redonne le texte authentique : outre les fautes typographiques, n’ont été rectifié[e]s que les “fautes de syntaxe et les impropriétés”, conformément au vœu de Radiguet tel que l’atteste Auric : “Pour en avoir longuement écouté tous les chapitres, je suis convaincu de connaître le Bal aussi complètement qu’il est possible. Et de connaître en même temps ce qu’étaient à son propos, en cet été 1923, les prochaines intentions de son auteur : pourchasser les fautes de syntaxe ou les impropriétés qui pouvaient y subsister.” »
Texte des éditions Grasset accompagnant la parution, en mai 2003, dans la collection « Les Cahiers rouges », de la « version originelle et intégrale, jusqu’alors inacessible au grand public », du Bal du comte d’Orgel, texte encore disponible sur le site de certaines librairies, dont celui de la Librairie Gallimard Montréal. « Un dossier donnant un éclairage sur les différents états du Bal du comte d’Orgel et une chrono-biographie complètent ce volume, édité et préfacé par Monique Nemer, biog[r]aphe de Raymond Radiguet. »