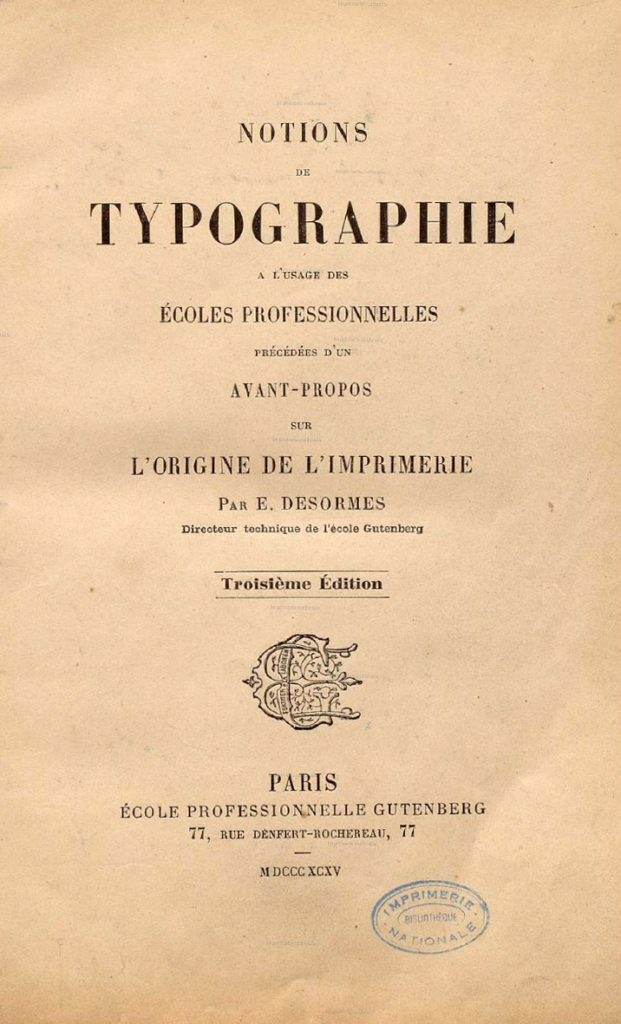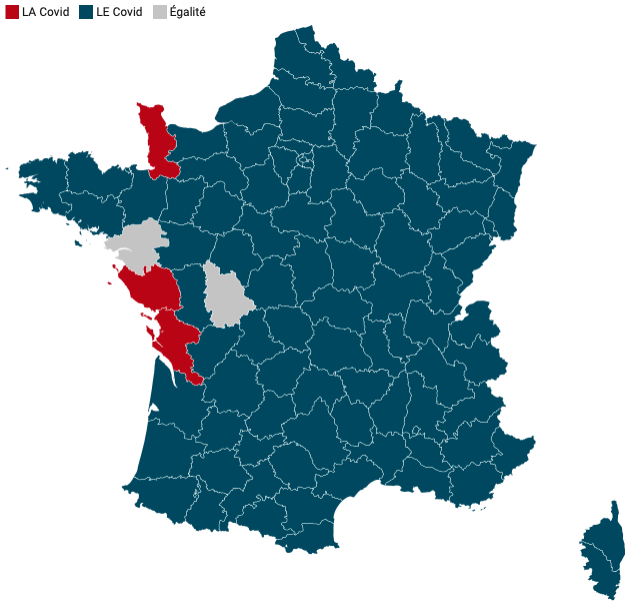Comment riez-vous par écrit ? Faites-vous « ah ah » ou « ha ha » ?
D’après un article de Libération en 2019, il y aurait débat sur la question. Il leur semble alors, « après une enquête toute subjective », que « ah ah » est plus fréquent.
Pourtant, le quotidien explique que les deux onomatopées sont admises, aussi bien par l’Académie que par le Robert.
Mais entre « Ah ! ah ! ah ! que c’est drôle ! » et « Ha ! ha ! ha ! comme c’est drôle ! », selon l’Académie, il y aurait une nuance d’affectation. Avec « ha ha », on fait plus semblant de rire qu’on ne rit vraiment.
Pour ce qui est de la ponctuation, vous avez le choix entre « Ah ! ah ! ah ! » et « Ah, ah, ah ! » (J’ai une préférence pour la seconde option, plus légère.)
Vous pouvez aussi faire « hi hi » si ça vous chante. Par contre, « hé hé » sert plutôt à « marquer une sorte d’adhésion gourmande, de complicité, parfois railleuse ou ironique » (Acad.). « Hé, hé, je ne dis pas non. » – à ne pas confondre avec « eh eh », qui « exprime un sous-entendu, généralement ironique ou grivois ».
Quant à « ho ho », c’est une exclusivité du père Noël.
Rire en ligne, c’est tout un art !
Entrées du Dictionnaire de l’Académie : ah ah ; ha ha ; hi hi ; hé hé ; eh eh.