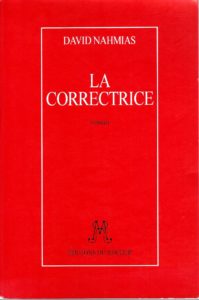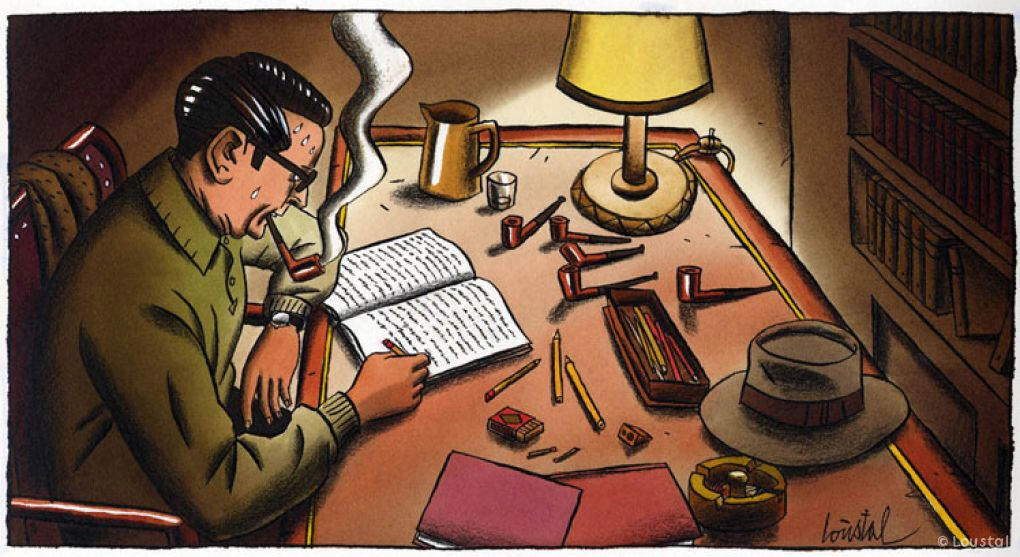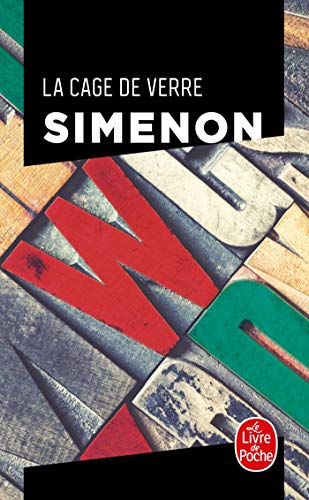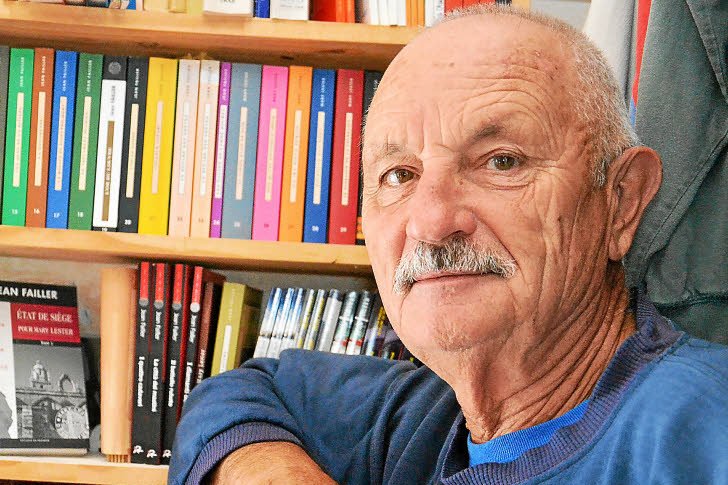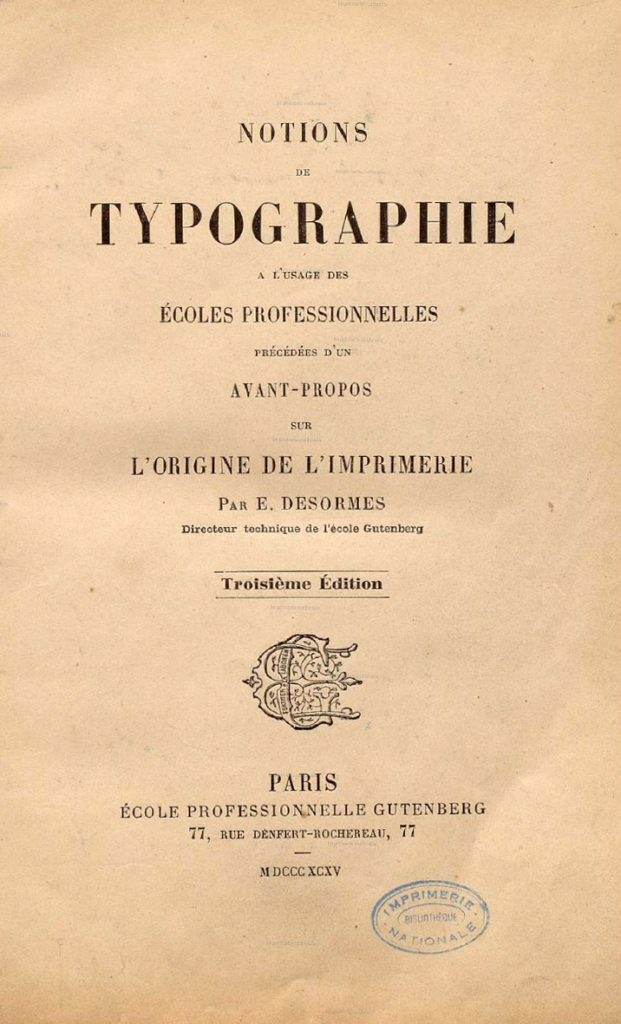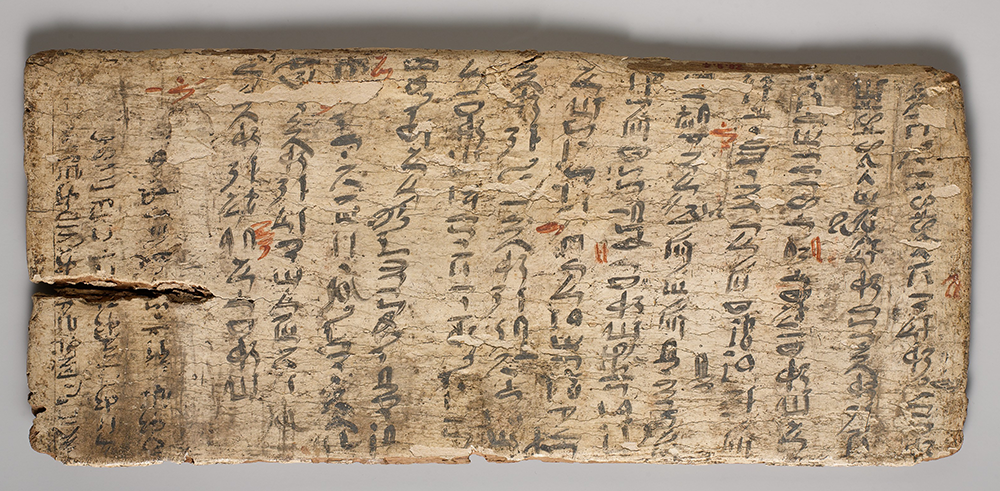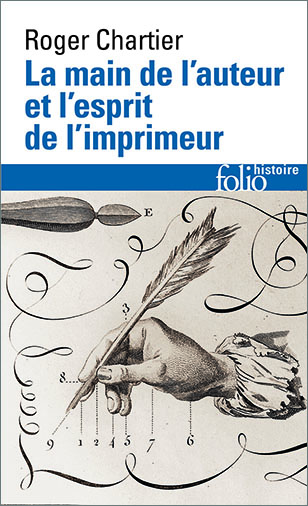« J’aime mieux être artisan que magistrat, gagner ma vie à la sueur de mon front que servir aux basses œuvres de la tyrannie. » — André Lemoyne, 1852
Rares sont les correcteurs auxquels on a érigé un monument. C’est pourtant le cas d’André Lemoyne (1822-1907), célébré comme poète, étudié par Verlaine1, préfacé par Sainte-Beuve et par Jules Vallès, multiprimé par l’Académie2 et fait chevalier de la Légion d’honneur en 18773. Si c’est le poète qui fut ainsi statufié, son passé de correcteur y est aussi inscrit à travers le comité qui a souhaité ce monument4 :

Il mourut le 28 février 1907 en sa ville natale, qui a donné son nom à une place publique. Ses amis, ses admirateurs lui ont élevé, par une souscription publique à laquelle la Société amicale des Protes et Correcteurs d’imprimerie de France a pris très largement part, un modeste monument qui fut inauguré le 31 octobre 1909, au Jardin public de Saint-Jean-d’Angély5.
Verlaine salue ainsi l’homme :
Lemoyne vit dignement d’un bel emploi dans la maison Didot. C’est l’homme du Livre comme c’est l’homme d’un livre. Quoi de plus noble et de plus logique ? Mais c’est aussi l’homme de la Nature merveilleusement traduite, du cœur combien finement deviné, de la femme sue et impeccablement appréciée, dite à ravir. Et quoi de mieux ?
Je reproduis ici le bel hommage que lui rend L.-E. Brossard, en 1924, dans Le Correcteur typographe6 :
« En plein rêve de jeunesse, alors que son esprit et son cœur débordaient des plus nobles ambitions, André Lemoyne, au milieu des événements de 1848, vit disparaître toute la fortune paternelle dans une catastrophe imprévue. Jeune et instruit, il eût pu se tourner vers la politique ou le journalisme, où, grâce à son talent d’avocat et à l’ardeur de ses convictions, il se fût taillé une brillante situation. André Lemoyne préféra devenir un simple artisan et ne devoir qu’au travail de ses mains le pain et la sécurité de ses jours : stoïquement, sans amertume, ni regret, il s’enrôla dans la phalange des travailleurs du Livre. Entré comme apprenti typographe dans l’imprimerie Firmin-Didot, André Lemoyne, que ses connaissances étendues et variées désignaient à l’attention de ses chefs, devint bientôt correcteur. Son érudition et son caractère lui conquirent, dans ce poste, des amitiés solides et l’estime d’auteurs illustres qui jugeaient à sa valeur la précieuse collaboration de ce travailleur discret. C’est dans ces fonctions que Lemoyne vit un jour, pour la première fois, la gloire venir vers lui : un académicien, M. de Pongerville, « en habit bleu à boutons d’or, pantalon gris perle à sous-pieds, chapeau blanc à longues soies », venait, au nom de l’Académie française, apporter ses félicitations et serrer la main au modeste correcteur qui se révélait un poète de premier ordre. »
André Lemoyne fut en effet un vrai poète : « dans la pratique de son métier de correcteur il avait découvert toutes les nuances, toutes les somptuosités du « verbe » ; nourri aux meilleures sources classiques, il avait sucé jusqu’à la moelle l’os savoureux de notre vieille littérature ; il en connaissait l’harmonieuse beauté et les ressources infinies ; il en comprenait la souplesse et la logique ; il l’aimait avec un respect, avec une admiration sincères. S’il concédait parfois qu’il est des difficultés, des contradictions, des illogismes qu’on peut sans dommage élaguer de la luxuriante frondaison de la grammaire et de l’orthographe, jamais il ne voulut admettre qu’on pût toucher aux règles ou aux formes grammaticales. Avec quelle amertume, lui d’ordinaire si doux, ne dénonce-t-il pas les infiltrations de mots étrangers :
… Je pense à toi, pauvre langue française,
Quand tu disparaîtras sous les nombreux afflux
De source germanique et d’origine anglaise :
Nos arrière-neveux ne te connaîtront plus !
« Travailleur d’élite probe et fidèle, Lemoyne ne pouvait oublier que pendant près de trente années il avait été du nombre de ces humbles et précieux auxiliaires de l’imprimerie, du nombre de ces érudits anonymes qui veillent au respect des belles traditions, du nombre de ces correcteurs qui éclairent les expressions obscures, redressent les phrases boiteuses et sont, suivant Monselet, les « orthopédistes » et les oculistes de la langue. Alors qu’il avait depuis longues années abandonné l’atelier pour remplir les fonctions de bibliothécaire archiviste à l’École des Arts décoratifs, n’avait-il point cet orgueil de montrer à ses intimes la blouse noire qu’il avait endossée au temps de sa jeunesse et de son âge mûr. N’est-ce point encore sur cette blouse qu’il épingla fièrement la croix, alors qu’il fut fait chevalier de la Légion d’honneur ? Au reste, ne proclamait-il point avec une ostentation de bon aloi : « Je connais mon dictionnaire. Songez que pendant trente ans j’ai été ouvrier typographe et correcteur chez Didot… » »