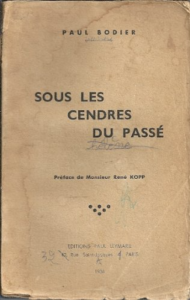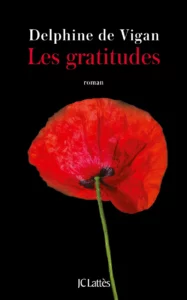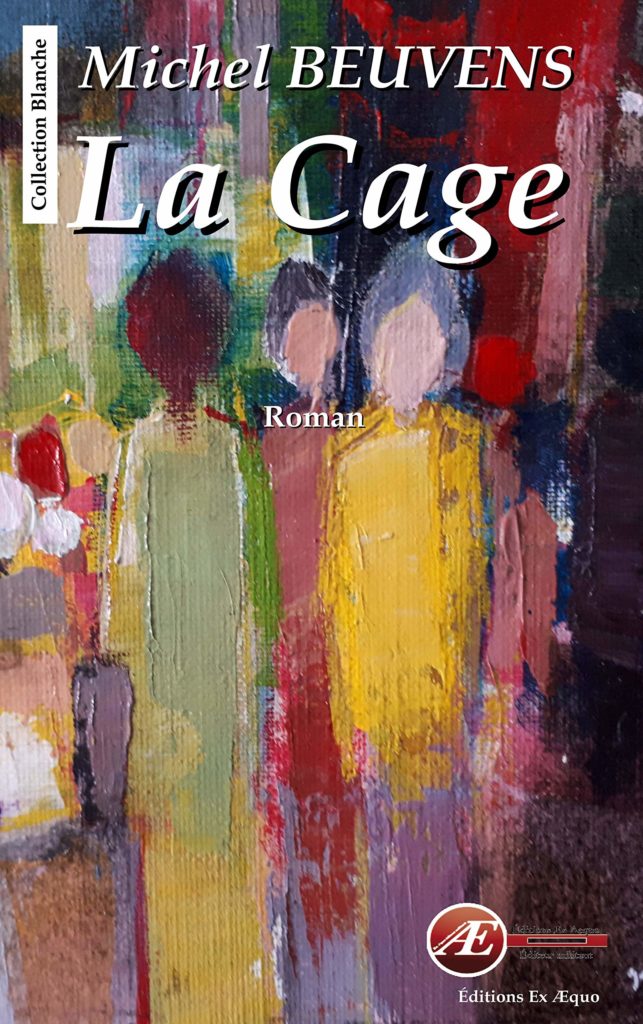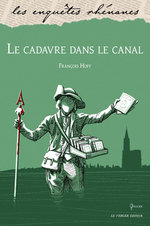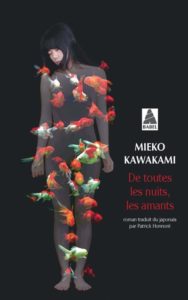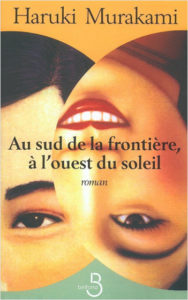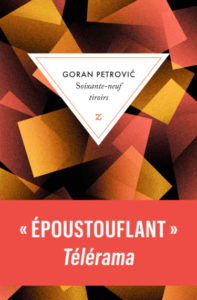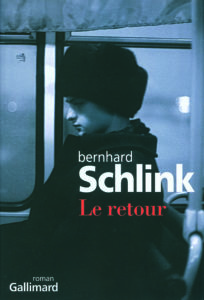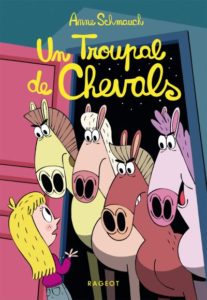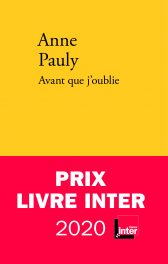Deux ans après ma précédente recherche de personnages de correcteur ou de correctrice dans les romans parus ces dernières années, j’ai relancé mes filets… et la pêche fut bonne. Dans ces nouvelles références, il y en a pour tous les goûts, de la romance à l’horreur. Faites votre choix !
Jean Anglade, Le Semeur d’alphabets, Presses de la Cité, 2007, 313 p. ; Pocket, 2009.
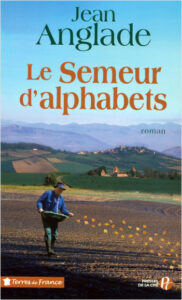
Après quarante ans de bons et loyaux services comme correcteur-typographe au quotidien La Montagne, Romain Fougères a bien mérité sa retraite. Mais à 55 ans, ce pur Auvergnat, énergique et généreux, ne peut se résoudre au bricolage. Une association humanitaire lui offre alors l’occasion de transmettre son expérience et d’agir selon sa conscience : elle recherche un bénévole pour créer une imprimerie au Congo. Avant le grand départ, Romain se remémore son existence paisible, celle d’un enfant de la campagne qui a connu la guerre, puis la transformation de Clermont-Ferrand de cité provinciale en métropole régionale, et qui, aujourd’hui, se prépare à l’aventure qui va couronner sa vie.
Jean-Charles Batllo, Le Destin d’Ovide, Edilivre, 2011, 198 p.
Ovide Willkingson, modeste correcteur des célèbres éditions Elseneur, publie les autres, mais se voit refuser tous ses manuscrits, jusqu’au jour où, à bout de patience, il décide de plagier, recopier et publier en son nom le manuscrit qu’il vient de recevoir. La terrible histoire de Benjamin Rouquier, orphelin violenté, spolié par un monde d’orgueil, de guerre, de puissants et de haine et la non-moins terrible histoire d’Hamlet, qu’il joue au théâtre, l’histoire de l’enfant qui a perdu la parole, en filigrane, s’enlacent alors dans une valse étourdissante où se mêlent réalité et fiction, envoûtant écheveau d’univers qui s’entrechoquent. Ainsi se dessine, en images parfois volées, le destin d’Ovide.
François Beaune, Un homme louche, Verticales-Phase deux, 2009, 352 p. ; Folio, 2011.

Un homme louche se donne à lire comme le journal intime d’un certain Jean-Daniel Dugommier, rédigé à deux époques cruciales de sa vie : sa jeunesse « autistique » au début des années 1980, puis son existence de trentenaire mal socialisé peu avant sa mort soudaine. Dans le « Cahier 1 », on découvre le collégien Dugommier, dit « le Glaviot », 13 ans, qui s’ennuie à mourir dans un lotissement où ses parents tiennent une petite épicerie. Sur fond de hard rock, il note les moindres détails de son quotidien de gamin en révolte latente et complexes inavoués. Il scrute ses voisins, théorise les tares familiales avec un mauvais esprit à l’ironie cinglante. Cette omniscience précoce trouve bientôt son explication : le jeune narrateur se sent doué de « superpouvoirs », une sorte de caméra spéciale implantée dans son cerveau lui permettrait de pénétrer les consciences de son entourage. Se croyant investi d’une mission d’observation ultrasecrète sur l’humanité, notre surdoué préfère se faire passer pour un attardé. Jusqu’à son internement d’office, son cahier ayant été finalement découvert par sa mère. Dès lors, ses prises de notes vont céder la place à une série de dessins désespérés, puis au vertigineux silence d’un doux dingue sous camisole chimique. Le « Cahier 2 » nous fait retrouver JDD à l’été 2008. À 39 ans, il est installé à Lyon où il est devenu correcteur à domicile. On reconstitue les pièces manquantes de son existence : sa tentative de vie conjugale, la mort tragique de son fils, ses errements au bistro, ses velléités sentimentales. Tout cela l’aura mené aux confins d’une existence a minima, moitié spéculative moitié végétative, avant qu’une rupture d’anévrisme vienne couper court à son ultime projet : rien moins qu’un attentat planétaire.
Nadine Bismuth, Scrapbook, Boréal, 2006, 400 p.
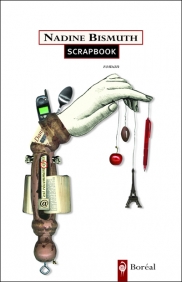
Aux éditions Duffroy, qui publient son premier roman, Annie Brière fait la connaissance de Laurent Viau, correcteur d’épreuves de son métier. Laurent Viau n’est pas insensible au charme d’Annie Brière, et une idylle se noue. Mais, après une nuit de passion, Annie apprend que Laurent Viau, s’il ne porte pas d’anneau à la main gauche, n’est pas pour autant célibataire. Elle devra donc trouver de façon urgente ce que signifie, pour elle, l’engagement amoureux. Devenue joueuse compulsive de Tetris, convertie aux vertus curatives de Leonard Cohen, du lac Champlain jusqu’à Paris, en passant par les cocktails littéraires de la maison Duffroy au Ritz-Carlton, y arrivera-t-elle ?
Chi Zijian, Bonsoir, la rose, trad. du chinois par Yvonne André, éd. Philippe Picquier, 2015, 192 p., poche, 2018, 224 p.
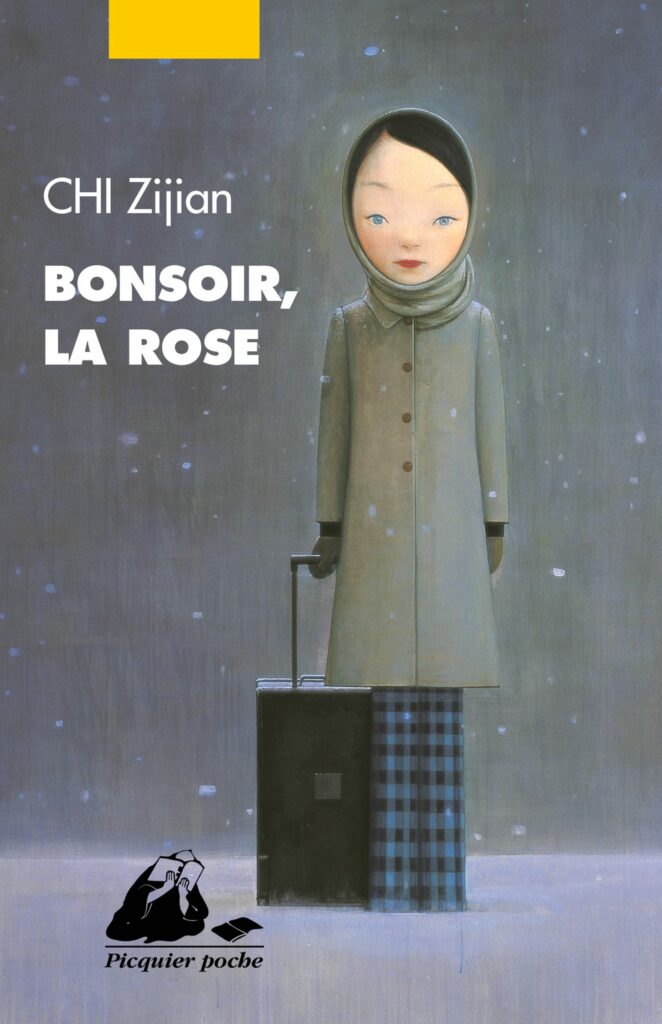
Il faut d’abord imaginer ce Grand Nord de la Chine aux si longs hivers, les fleurs de givre sur les vitres et l’explosion vitale des étés trop brefs. Puis Xiao’e, une jeune fille modeste, correctrice d’épreuves dans une agence de presse, pas spécialement belle, dit-elle, pour qui la vie n’a jamais été tendre : « j’appartenais à une catégorie insidieusement repoussée et anéantie par d’invisibles forces mauvaises ». Et puis Léna aux yeux gris-bleu et au mode de vie raffiné, qui joue du piano et prie en hébreu, dont le visage exprime une solitude infinie. Elle qui avait une vie intérieure si riche, comment pouvait-elle ne pas avoir connu l’amour ? Xiao’e rencontre donc Léna, une vieille dame juive dont la famille s’est réfugiée à Harbin après la révolution d’Octobre. Tout semble les opposer, pourtant on découvrira qu’un terrible secret les lie.
Annie Cluzel, Lily-Jeanne, Edilivre, 2018, 136 p.
L’écrivaine Annette, exaltée par le succès de ses premiers livres, se trouve soudainement confrontée à un terrible manque d’inspiration. Dépitée mais souhaitant néanmoins rester dans le milieu littéraire, elle devient correctrice. Mais œuvrer dans l’ombre des autres, de ceux qui ont des idées, l’ennuie jusqu’au jour où elle reçoit un manuscrit à corriger dont l’histoire va bouleverser sa vie. Une histoire qui va la ballotter entre l’écriture et la correction et qui va lui permettre de faire une bien curieuse rencontre.
Vincent Cespedes, Mot pour mot, Flammarion, 2007, 288 p.
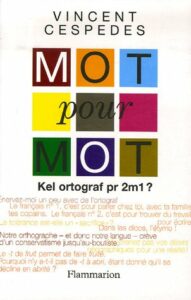
Louis et Noémie se rencontrent dans le TGV. Noémie étant sourde, ils dialoguent par écrit. Désabusé et adepte du « tout fout le camp », Louis enseigne dans un collège de banlieue et distribue des 00/20 à chaque dictée. Noémie, elle, est intime avec un correcteur professionnel et se passionne pour la liberté graphique avec laquelle la jeune génération pratique l’écrit (SMS, blogs, Internet…). Inévitablement, l’orthographe devient le thème central de leur conversation ferroviaire, et à chacun de leurs trajets le débat fait rage.
Horacio Castellanos Moya, Déraison, trad. de l’espagnol par Robert Amutio, Les Allusifs, 2006, 144 p. ; 10/18, 2009.
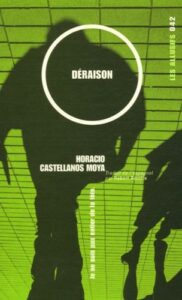
À travers un monologue ressassant, qui brasse des faits terribles, des interprétations plus ou moins assurées, des scènes à caractère hallucinatoire, un narrateur raconte en 12 chapitres les étapes d’une descente aux enfers, ses propres enfers et ceux d’une société qui baigne dans la violence et le meurtre, comme dans son élément naturel. Ce narrateur, homme sans nom et étranger au pays où il se trouve, est devenu un exilé volontaire afin de fuir les persécutions entreprises par les autorités de son pays. Il lit et corrige un rapport élaboré par l’Église catholique dans lequel sont reportés minutieusement les massacres d’Indiens, toutes les exactions et les violations de ce que l’on nomme les droits de l’homme, commis par des militaires, nommément désignés et dont l’impunité est totale et le pouvoir de nuire et de tuer, encore immense. Chaque chapitre mêle dans les propos emportés du narrateur des descriptions des atrocités de l’armée, des citations des témoignages des survivants assimilées à la plus haute poésie, et les inquiétudes personnelles de ce correcteur — le sexe, la peur, la panique, la colère et la rage qui naissent de tout incident quotidien, le tout plongé dans un fort courant que le narrateur lui-même nomme paranoïa.
Didier da Silva (texte) et François Matton (dessins), Une petite forme, P.O.L, 2011, 112 p.
Le texte de Didier da Silva met en scène un personnage dont le métier, il est « travailleur à domicile », consiste à corriger de stupides romans d’amour, et que cela déprime – on le comprend. Il se livre donc à une suite de considérations désabusées sur la vie et sa vie, pleines d’humour et d’autodérision, de lucidité. C’est drôle et touchant, juste, discrètement désespéré. Les dessins de François Matton qui constellent ce récit, qui parfois l’interrompent, lui font un écho très réussi, joliment dévié parfois.
Hugo Horst, Les Cendres de l’amante asiatique, Zulma, 2002, 128 p.
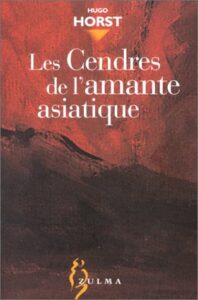
Schlomo est un flic solitaire, parisien dans l’âme, qui se nourrit de rouleaux de printemps rue de Belleville. C’est une sorte d’artiste qui a tout pour faire un bon flic. D’ailleurs, c’est un bon flic. Alors qu’il enquête sur le meurtre de l’écrivain Jérôme Carné, il sauve de la noyade une jeune Chinoise, correctrice d’imprimerie. Il la croisera de nouveau à une signature en librairie, autour d’un pamphlet détonnant : Le nègre se rebiffe.
Entre cocktails, plumitifs, nègres et académiciens, un portrait satirique du milieu de la presse et de l’édition. Avec en toile de fond, la ville énigmatique et souveraine.
Pierre Kyria, Les Yeux de la nuit, éd. du Rocher, 2018, 318 p.
« Je vois les choses de loin, mais avec une telle intensité qu’elles me semblent avoir un relief qu’elles n’ont peut-être pas. J’extrapole et leur confère une signification qui est peut-être illusoire. » Qu’est-ce qui pousse Émile Vanier à venir, chaque nuit, coller le nez à la vitre de son appartement de la butte Montmartre ? Veut-il élucider l’envers des apparences, débusquer les marges illogiques de l’existence courante ? Son voyeurisme ne cherche pas un assouvissement des sens mais un apaisement de l’esprit. Mais pourquoi se sent-il traqué ? Encore jeune, il travaille comme correcteur dans une maison d’édition, et va découvrir, sous la férule d’un éditeur équivoque et cajoleur, toutes les ambiguïtés d’une société partagée entre le faire-valoir culturel, la noble attitude, et un mercantilisme cynique, un « monde de l’esprit » qui ne joue pas franc jeu, où Émile se sent l’otage des séduisants caprices de son patron. Malgré ses efforts pour s’assimiler, il se sent piégé par un sentiment de non-appartenance, hanté par des questions qui ne trouvent pas de réponse. Comment son père a-t-il mystérieusement disparu lorsqu’il était enfant ? Pourquoi son oncle et ex-tuteur, un riche expert financier, veut-il à tout prix lui racheter son appartement ? Que cherche donc la ravissante Anglaise qui croise toujours son chemin et finit par partager son intimité tout en se refusant à ses avances ? Au bout de ses quêtes, Émile Vanier va découvrir les vérités fondamentales de son destin, si longtemps dérobées dans ce qu’elles ont de monstrueux, ayant fait de lui, à son insu, un outsider qui aspire à être un homme-chat.
Marco Lodoli, Boccacce, trad. de l’italien par Lise Capuis et Dino Nessuno, illustrations d’Alban Caumont, L’Arbre vengeur, 2007, 120 p.
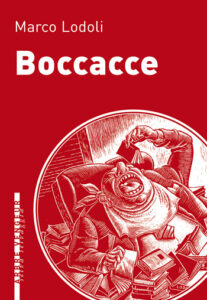
Boccacce ! Prononcez-le à votre guise mais en tordant la bouche, comme si vous grimaciez en catimini.
Car les nouvelles réunies ici par Marco Lodoli, une des plus fines plumes contemporaines italiennes, ont le dessein de vous faire ricaner. Concentrant leur acidité sur la bêtise, la vanité, ou la folie des antichambres du monde délirant de l’édition, elles forment une sarabande joyeuse mais inquiétante dans laquelle le correcteur vous corrige, l’éditeur vous menace, le traducteur vous navre, l’universitaire vous vampe, le critique vous guillotine, l’auteur se venge… Quant au libraire ? Ne vous retournez pas, il vous observe et c’est peut-être dangereux… Boccacce ou comment être perfide sans cesser de sourire.
☞ Lire l’extrait que j’ai publié.
Alexandra Lucas Coelho, Mon amant du dimanche, trad. du portugais par Ana Isabel Sardinha Desvignes et Antoine Volodine, Seuil, 2016, 228 p.
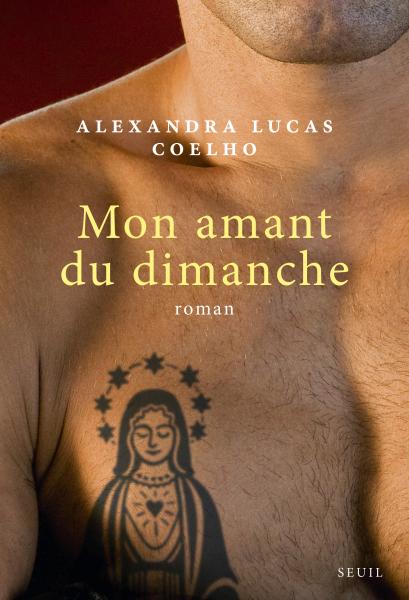
Une femme crie vengeance. Un homme l’a trahie et elle est bien décidée à avoir sa peau. Celle qui raconte cette histoire est célibataire, sans enfants, et trouve dans ses cinquante ans et ses cinquante kilos une énergie dévorante. Vivant dans l’Alentejo où elle travaille comme correctrice pour une maison d’édition, elle ne quitte sa campagne qu’une fois par semaine. Elle se rend alors à Lisbonne où elle a pour mission de changer, chaque dimanche, la litière du chat d’une amie partie en voyage. C’est entre son domicile, l’appartement où l’attend le chat et la piscine qu’elle prendra sa revanche. Son plan l’occupera tout un mois et sa réussite sera totale. Ses complices ? Les livres, la natation, un été torride. Et trois amants du dimanche, aussi différents que vivifiants.
Alfonso Mateo-Sagasta, Voleurs d’encre, trad. de l’espagnol par Denise Laroutis, Rivages, « Thriller », 2008 ; « Noir », 2011, 688 p.
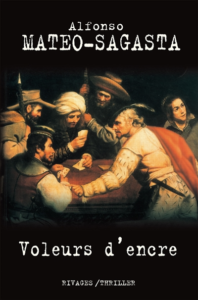
Dans le Madrid du Siècle d’Or, Isidoro Montemayor supervise un tripot où viennent s’encanailler de nobles dames. L’établissement appartient à son maître, Francisco Robles, qui est par ailleurs éditeur et emploie aussi Isidoro comme rédacteur-correcteur. Robles ne décolère pas. Il a publié le Don Quichotte ; mais un certain Alonso Fernández de Avellaneda vient de sortir au nez et à la barbe de Cervantès une suite à son chef-d’œuvre. Une suite qui n’est autre qu’un livre à clés, diffamatoire envers plusieurs personnalités, dont Cervantès lui-même. Décidé à découvrir qui se cache derrière ce pastiche, Robles envoie Isidoro à la recherche d’Avellaneda. Une enquête picaresque au cœur de grandes œuvres littéraires, dont les pages peuvent receler de brûlants secrets. À condition de savoir les interpréter.
Marcel Moreau, Julie ou la dissolution, Espace Nord, 2021, 187 p. Réédition d’un roman de 1971.

Julie Malchair, nouvelle dactylo pour une revue scientifique, est une femme d’une beauté charmante et perturbante, apparemment sans passé. Elle fait irruption dans la vie de Hasch, correcteur, et dans celle de ses collègues. Par sa paresse et sa perversité naïve, elle les entraîne à se libérer des contraintes que la routine et les règles de la vie sociale leur imposent. S’ensuit alors une dérision totale du travail, notamment par l’introduction du vin et de drogues qui conduisent à un festin orgiaque dans le bureau. Sa tâche accomplie, Julie disparaît.
D’après la quatrième de couverture, Marcel Moreau (1933-2020) fut correcteur à Bruxelles pour le quotidien Le Soir, à partir de 1955, puis à Paris, à partir de 1968, pour Alpha Encyclopédie, Le Parisien libéré et Le Figaro. « Considéré comme un écrivain marginal, au style verbal fort singulier – véhément et organique, teinté de lyrisme et d’envolées paroxystiques, tout à la fois caressant et bousculant –, il est l’auteur d’une œuvre ample et foisonnante, foncièrement charnelle. »
Guadalupe Nettel, Après l’hiver, trad. de l’espagnol (Mexique) par François Martin, Buchet-Chastel, 2016, 304 p.
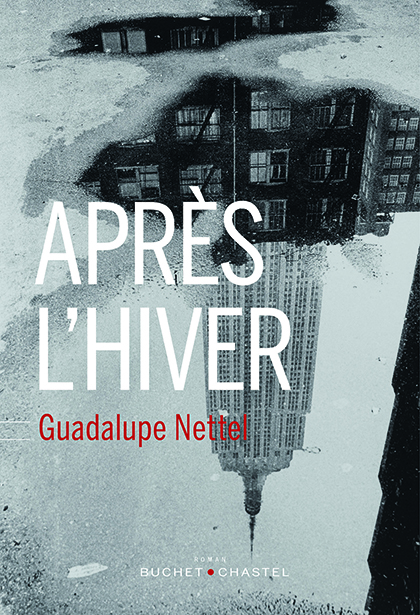
Claudio, exilé cubain de New York, correcteur pour une maison d’édition, a une seule passion : éviter les passions. Cecilia est une jeune Mexicaine mélancolique installée à Paris, vaguement étudiante, vaguement éprise de son voisin, mais complètement solitaire. Chapitre après chapitre, leurs voix singulières s’entremêlent et invitent le lecteur à les saisir dans tout ce qui fait leur être au monde : goûts, petites névroses, passé obsédant. Chacun d’eux traîne des deuils, des blessures, des ruptures. Lorsque le hasard les fait se rencontrer à Paris, nous attendons, haletants, de savoir si ces êtres de mots et de douleurs parviendront à s’aimer au-delà de leurs contradictions.
Frédérique Noëlle, Embarquement pour Cythère, Les Éditions du Net, 2014, 546 p.
L’une vit à Bordeaux, est un écrivain à succès, mère célibataire, une fille de 9 ans, et une famille omniprésente. Elle craque sur son nouveau voisin, un jeune libraire allemand. Mais est-il réellement celui qu’il prétend ? L’autre vit à Soulac, est correctrice pour une maison d’édition, et atteinte d’une tumeur. Pour tenter de réaliser ses derniers rêves et offrir à sa fille des souvenirs inoubliables, elle entreprend avec elle une croisière jusqu’en Polynésie, qui va les mener beaucoup plus loin que prévu. Deux vies, deux femmes ?
Frédéric Roux, Contes de la littérature ordinaire, Mille et une nuits, 2004, 144 p.
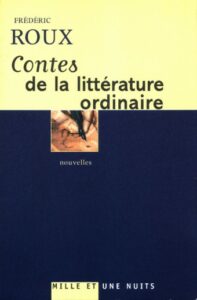
« Il était mûr pour les humiliations majeures, car l’auteur, il l’apprendrait à ses dépens, avant de pouvoir faire des caprices, ne se conçoit qu’humilié. Il aurait pu faire la liste : le correcteur dyslexique, les maquettes foirées, les couvertures nulles, les coquilles qui crevaient les yeux ; le journaliste qui comprenait tout à l’envers, celui qui n’avait pas même lu la quatrième de couverture ; les salons du livre dans des contrées reculées où personne ne se pointait sinon le poète local qui postillonnait et finissait par vouloir lui casser la gueule, la Fête de l’Huma où il avait attrapé une insolation ; les collègues jaloux, les crocs-en-jambe, les insinuations mensongères, les amitiés défaites, les changements de personnel, les bruits de couloir et l’âge qui venait sans que jamais rien ne change. Il se déplumait sous le harnois comme le cou du chien de la fable.
Après lecture, il s’avère que les seules mentions du métier de correcteur figurant dans le livre sont les mots en gras ci-dessus, mais j’ai tellement ri en le lisant que je le maintiens dans la liste, en vous recommandant vivement de vous le procurer. C’est vraiment « une vigoureuse satire de la machine éditoriale et de ses noires vicissitudes », comme l’annonce l’éditeur.
Uwe Tellkamp, La Tour, trad. de l’allemand par Olivier Mannoni, Grasset et Fasquelle, 2012, 976 p. ; J’ai lu, 2013.
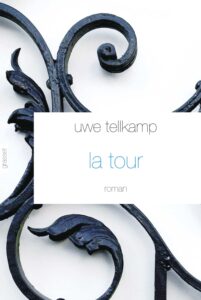
Dresde, 1982. Les habitants d’un quartier résidentiel cossu se sont depuis longtemps accommodé des conditions de vie. Pourtant, les membres de cette bourgeoisie est-allemande, véritable anachronisme en RDA, s’isolent parfois pour tourner le dos à la grisaille quotidienne. À commencer par Meno, correcteur pour une maison d’édition, qui se doit de composer avec la censure ; mais aussi son beau-frère, chirurgien qui mène une double vie et qui, avec sa femme, aveugle et aimante, a élevé son fils. Celui-ci est un éternel incompris qui incarne pour l’Homme Nouveau dont le nom rayonnera un jour, dans le respect des plus belles valeurs — vie familiale harmonieuse, amour de la culture, pratique de la musique, travail acharné. Toutefois, cette peinture idyllique ne tarde pas à se lézarder et bientôt, c’est le pays tout entier qui tremble…
☞ Voir aussi ma première sélection, « Le correcteur, personnage littéraire ».
Article mis à jour le 26 avril 2024.