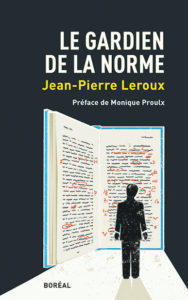
Le Gardien de la norme est un livre posthume de Jean-Pierre Leroux (1952-2015), qui a passé « quarante ans à hanter les coulisses de la littérature ». C’est, en quelque sorte, le testament de ce réviseur linguistique, « privilégié d’un très grand nombre d’écrivains québécois […], réclamé par tous ceux qui le disaient le meilleur » (dixit Monique Proulx, dans sa préface).
Sur la forme, ce livre tient plus du recueil de « morceaux » que de l’ouvrage construit. En tout cas, ce n’est « ni un traité ni un manuel de révision », ce que l’auteur admet lui-même dans son avant-propos – précision qui aurait été utile dans la présentation de l’éditeur.
Quel est le rôle exact du réviseur littéraire, notion spécifiquement québécoise ? En quoi diffère-t-il du correcteur ? Et à quel stade de la chaîne éditoriale intervient-il ? Le manuscrit ayant été « scruté » et validé par l’éditeur :
Le réviseur linguistique […], qui est le maillon suivant, se préoccupe de la correction […] de la langue. Par la suite, le texte modifié est revu par l’auteur et l’éditeur, et mis en pages. Entre alors en scène le correcteur d’épreuves, qui, au cours de sa lecture, vérifie que les corrections retenues ont été apportées et peut suggérer d’autres changements. Enfin, la révision revoit les dernières corrections, sans qu’il soit indispensable – si chacun a bien fait son travail – de relire le texte en entier, d’autant plus que l’éditeur est soumis à des contraintes temporelles et financières.
Le titre donné à l’ouvrage, « Le gardien de la norme », est en fait celui de la première partie du livre, la seule qui parle vraiment de révision linguistique (p. 25-74). La seconde partie évoque la courte expérience de l’auteur comme directeur littéraire. La troisième rassemble des portraits d’écrivains et d’éditeurs québécois1. La quatrième peut être qualifiée de « notes de lecteur » (sur Thomas Bernhard, Philip Roth, Pessoa… et sur Le Petit Robert, j’y reviendrai). Enfin, une courte fiction vient clore l’ouvrage.
La norme, mais laquelle ?
« Garder, c’est surveiller, non pour prendre en flagrant délit, mais pour mettre à l’abri2. C’est protéger, non contre le changement, mais contre la disparition, l’écroulement. Le tout dans le silence recueilli de la lecture. »
Le réviseur linguistique est donc le gardien de la norme… mais de laquelle ? Car « La langue est mouvante, elle évolue petit à petit, au gré des idées, des circonstances, des modes, des erreurs ».
Sur quelle norme le réviseur linguistique doit-il s’appuyer ? Les dictionnaires, comme Le Petit Robert, un excellent condensé (Le Grand Robert aussi, bien sûr, mais ses dimensions rendent difficiles au quotidien sa manipulation et son rangement), et les grammaires, comme Le Bon Usage, l’espèce de cahier des normes du français. Mais il s’avère parfois ardu d’appliquer des normes qui ne semblent pas claires ou logiques.
Suivent quelques exemples, que l’auteur conclut par deux questions : « Doit-on lutter contre des emplois que l’usage a fini par imposer ? Doit-on tolérer des termes (comme solutionner) pour lesquels il existe déjà un équivalent correct (résoudre) ? » N’y pas répondre, c’est admettre que tout correcteur ou réviseur y est confronté chaque jour : il est seul responsable de ses choix, de l’endroit où il place le curseur normatif.
Le “rituel de la révision”
Leroux aborde ensuite le travail de la révision lui-même, à effectuer sur « une table bien ordonnée » :
Tout doit être à sa place. Le stylo rouge qui répandra le sang des corrections sur les feuilles, le crayon à mine pour les discrètes et effaçables annotations et interrogations dans la marge de gauche, les stylos de couleur pour les notes de toutes sortes à prendre sur une feuille à part, la règle à poser sur la page à lire de manière à masquer les lignes suivantes, et donc à freiner la lecture, une calculatrice de poche permettant de vérifier les opérations fondamentales dans les tableaux et d’établir la feuille de temps du réviseur, des autocollants colorés, une montre (ou l’heure à l’écran de l’ordinateur) pour consigner le temps notamment du début du travail et de sa fin, un contenant rempli de trombones, de pinces ou d’élastiques pour regrouper des feuillets.
Les sources qu’il garde à portée de main sont les suivantes : Le Petit Robert, Le Bon Usage, L’Art de conjuguer de Bescherelle, Le Petit Robert des noms propres, Le Grand Dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française ou d’autres sites encyclopédiques comme Wikipédia, le Multidictionnaire de la langue française pour les emplois québécois, Le Colpron pour les anglicismes, Le Ramat de la typographie, Le Dictionnaire visuel « et d’autres ouvrages, selon les matières à réviser ».
Robert plutôt que Larousse
Pourquoi préfère-t-il Le Petit Robert ? Parce que « les définitions sont souvent portées à un haut degré de précision, de concision, d’élégance ». Il rend un bel hommage à ce dictionnaire en y piochant au hasard des citations puis en s’amusant à « décortiquer les définissants, qui composent une définition ». De son côté, Le Petit Larousse « a l’avantage de présenter des illustrations et de donner des définitions concises, mais cette condition devient un inconvénient pour le professionnel des mots, qui y trouve peu d’exemples d’emploi des termes ». Le Robert est « le livre à emporter sur une île déserte ».
Sur écran ou sur papier ?
Et l’ordinateur ? S’il est bien présent, « au fond de la table, ou sur une table qui lui est réservée », il n’est pas utilisé en première intention :
[…] les réviseurs linguistiques préfèrent souvent entreprendre leur lecture sur papier, pour avoir la sensation de mieux voir le texte, de mieux flairer ses pièges, dans le format traditionnel, circonscrit et rassurant de la feuille, sans la lumière surajoutée de l’écran à la page se déroulant presque à l’infini. Il s’agira ensuite de transcrire les corrections dans le fichier, de se relire à l’écran. Mais chaque réviseur a sa méthode, et il n’est pas impossible que les travailleurs plus jeunes jugent inutiles, d’une époque révolue, la copie papier.
Le travail lui-même
Jean-Pierre Leroux recommande la double lecture, au rythme d’un paragraphe à la fois :
Le réviseur peut privilégier le paragraphe comme frontière naturelle de la lecture initiale, parce qu’il faut bien s’arrêter quelque part avant de se relire. Arrivé à la fin du paragraphe, il le reprend. Sans ces deux premières lectures, il paraît impossible d’espérer appréhender l’ensemble du texte. La première lecture, essentiellement visuelle, mécanique, se présente comme une suite de mots – du vocabulaire, des éléments liés entre eux par des conjonctions et des prépositions –, et le sens s’esquisse bien entendu, mais il est en grande partie dissimulé derrière les signes graphiques. La deuxième lecture, déjà plus distanciée, comme une vue en plongée, permet d’apercevoir ce que les mots cherchent à dire, va au-delà de la syntaxe et du sens sommairement perçu. Elle livre un sens plus global.
Se contenter d’une première lecture :
Ce serait faire appel à plusieurs habiletés simultanément, sachant en outre que certains aspects du texte sollicitent un savoir courant, profondément ancré depuis l’école et au fil des lectures, tandis que d’autres aspects requièrent des vérifications parfois poussées.
Secrets du bon travail
Les correcteurs savent bien qu’ils doivent toujours douter :
La règle d’or est de ne jamais se presser. […] il faut être prêt à tout chercher, et d’abord ce qu’on croit connaître. […] Cette recherche de l’évidence est d’ailleurs une des manières de se ménager de belles surprises, de découvrir des faits de langue qu’on ignorait […].
Leroux aborde le problème des répétitions de mots et expressions, ceux que l’auteur emploie de nouveau parce qu’il les a gardés en mémoire ou parce qu’ils sont ses termes fétiches.
Le Petit Robert s’avère dans ces circonstances d’un précieux secours, mais il est souhaitable d’écarter les synonymes évidents qu’il fournit […] et de faire appel à un mot paraissant éloigné mais approprié au contexte, quitte à soumettre à l’auteur la reformulation d’un segment de phrase.
En cas de panne, ne pas hésiter à « laisser un signe […] ou une note […] à la mine dans la marge et à y revenir plus tard […] dans la plupart des cas, à la suite de cette pause, le terme recherché se détache de lui-même. »
Faut-il tout vérifier ?
Autant que possible, oui, mais en reconnaissant ses limites :
[…] l’auteur doit assumer l’exactitude des faits, des données et des chiffres qu’il avance, à plus forte raison lorsque le sujet est très spécialisé ou technique. […] Par contre, [le réviseur] est susceptible de poser des questions ou d’émettre des commentaires, et même des doutes. Et rien ne l’empêche non plus, pourvu qu’il garde son sang-froid […], de signaler un préjugé, quel qu’il soit. […] il a tout à fait le droit se se mêler de ce qui ne le regarde pas, sans toutefois jamais perdre de vue l’idée que toute correction ou toute recommandation qu’il fait reste une suggestion, car le texte ne lui appartient pas.
Rester humble
Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante : elle a trait aux limites d’intervention du réviseur.
Le réviseur peut être porté sans trop s’en rendre compte à manifester ses préférences, à ajouter sa propre couleur, ce qui risque d’altérer l’esprit du texte. L’insécurité est liée à la crainte que le travail linguistique ne soit pas reconnu, ou soit jugé insuffisant, s’il n’entraîne pas un nombre appréciable et bien visible de corrections. Il est loin d’être toujours facile pour le réviseur de n’apporter que les changements strictement nécessaires. Cela implique d’accepter une formulation qui ne lui plaît pas malgré qu’elle soit correcte, de ne pas remplacer une expression conforme par celle qu’il choisirait s’il écrivait lui-même, de ne pas effectuer une sorte de nivellement correspondant finalement à sa propre façon d’écrire. Ainsi, le réviseur ne peut modeler l’écriture à sa guise, supprimer ce qui le dérange, orienter une idée dans un sens qui lui paraîtrait préférable. Car l’application de normes ne doit jamais empiéter sur la personnalité du ton. On peut appeler ça l’humilité du technicien.
On reste d’autant plus facilement humble que ce travail est généralement mal considéré et mal payé (en 2015, avec trente ans d’expérience, on touche péniblement 25 dollars l’heure dans l’édition littéraire, selon Leroux). Cependant, pour sa propre satisfaction comme pour celle de son client, il faut travailler « le mieux possible, en y mettant toute [s]a concentration et toute [s]on énergie ».
Les vingt pages que je viens de synthétiser, les seules évoquant concrètement notre pratique, sont suivies d’un dialogue imaginaire illustrant la méconnaissance dont la profession est le plus souvent victime – on en trouve un équivalent au début du livre Au bonheur des fautes de Muriel Gilbert3. Puis, à travers quelques anecdotes, Jean-Pierre Leroux relate des expériences difficiles de collaboration avec l’auteur, qui a besoin d’être rassuré avant de pouvoir admettre des corrections vécues comme des « intrusions ».
Après un court commentaire d’une citation de Raymond Carter sur la révision du manuscrit, l’auteur propose des considérations générales sur la ponctuation (grammaticale plutôt qu’orale), les pléonasmes (certains sont admissibles) et l’« écriture formatée » des romans jeunesse et policiers, qui n’apprendront sans doute rien au correcteur professionnel.
Il ne faut pas chercher dans ce livre la « réflexion fascinante sur la pratique de ce métier de l’ombre » que nous annonce l’éditeur en quatrième de couverture. Plutôt, comme le résume la préfacière, « un journal intime, à l’écriture frémissante et précise, qui nous dévoile les forces et les blessures d’un homme habité par la passion de son métier ». Il satisfera donc davantage l’amateur de littérature (surtout québécoise) que le correcteur en recherche de formation professionnelle.
☞ Voir ma Bibliothèque du correcteur.
Jean-Pierre Leroux, Le Gardien de la norme, Les Éditions du Boréal, 2016, 256 pages.
- Lire l’article de Louis Cornellier, « Le talent caché derrière les écrivains », dans Le Devoir, 22 octobre 2016.
- Cette phrase a inspiré le titre d’une série de podcasts québécois sur le métier de réviseuse, « Gardiennes averties » (Aparté, éd. Alto, 2021), où Jean-Pierre Leroux est bien sûr évoqué.
- La Librairie Vuibert, 2017 ; coll. Le Goût des mots, Points, 2019.