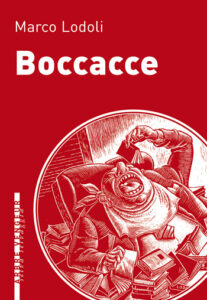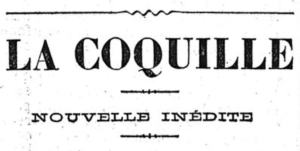À l’occasion des fêtes de Noël, j’ai choisi de publier une belle histoire de fraternité humaine, liée au monde de l’imprimerie, publiée à Paris au milieu du xixe siècle. Un printer’s devil est un apprenti compositeur, employé très jeune pour les travaux les plus salissants de l’atelier. Souvent maltraité par les ouvriers comme par les maîtres, il doit apprendre à se défendre, tant physiquement que verbalement, et devient « un vrai diable, tapageur, tourmenteur, raisonneur, flâneur, batailleur » (dixit l’introduction du texte). Mais Victor va montrer aussi sa générosité. (J’ai respecté l’orthographe et la ponctuation d’origine, ne corrigeant que les rares coquilles.)

Victor Dutuy, grand et gros garçon de quatorze ans, apprenti compositeur depuis deux ans chez M. Fiéville, imprimeur à Rouen, n’était pas moins franc gamin que tous ses honorables collègues de la même partie. Je ne vous dirai pas non plus que sa toilette était plus soignée, ses manières plus choisies, sa conversation plus recherchée que celle de tous ses camarades. C’était un vrai printer devil1 dans toute l’acception du mot ; cependant, sous cette rude et assez grossière écorce, battait un cœur sensible. Victor s’enthousiasmait à la lecture d’un beau trait2 ; un acte de générosité le transportait ; tout ce qui était noble et beau trouvait facilement le chemin de son [â]me. Ne vous figurez pas pourtant que Victor épanchât ses émotions en phrases plus ou moins sentimentales ; le garçon était fort peu exclamatif et phraseur encore moins. C’est beau ça ! s’écriait-il, et là s’arrêtait son expansion. Ou bien : Voilà un gaillard qui peut se vanter d’avoir mon estime… Et c’était tout. Mais pour ne pas parler beaucoup, Victor ne pensait pas moins. Or, vous saurez que les parens3 de Victor, sans être riches, étaient de laborieux ouvriers qui vivaient assez bien, et laissaient à leur fils le produit de son travail, produit bien mince encore, avec la seule recommandation d’en faire un bon usage ; ils avaient assez de fois éprouvé leur enfant, pour lui donner, sans danger, cette honorable marque de confiance.
L’étrange voisin d’en face
Dans la maison qu’habitait la famille de Victor, et dans une chambre, dont les fenêtres donnaient juste en face des croisées de celui-ci, vivait un pauvre jeune homme, dont l’existence singulière, la tournure et les manières étaient de nature à exciter une curiosité moins prompte à s’allumer que celle de notre garçon. Léon, le jeune homme en question, sortait régulièrement tous les jours vers neuf heures du matin, et s’absentait jusque vers cinq heures de l’après-midi ; alors, il rentrait chez lui, et ne sortait plus que le lendemain à la même heure que la veille. D’un aspect sérieux, quoique doux, d’une politesse constante, mais froide, vis-à-vis de tous ses voisins, Léon ne s’était lié avec aucun d’eux, ce qui contribuait davantage encore à lui attirer leur attention ; car les gens du peuple sont généralement communicatifs ; ils aiment à se lier entre eux ; ils savent qu’à tout instant, ils peuvent avoir besoin l’un de l’autre, et il est mille circonstances o[ù] la bonne volonté d’un voisin obligeant n’est pas à dédaigner. La conduite de Léon devait donc leur sembler étrange, et ils se demandaient ce que pouvait être et faire le pâle et sévère jeune homme. Victor n’était pas un des moins empressés de soulever le voile qui couvrait la vie du voisin mystérieux ; mais, plus naïf et plus hardi que les autres, il ne manquait pas une occasion de s’en rapprocher. S’il le voyait paraître un moment à sa fenêtre : « Bonjour, M. Léon, vous vous portez bien, » lui disait-il aussitôt. Si par hasard, il le rencontrait le dimanche, sortant ou rentrant, il ne manquait pas de phrases toutes faites pour chercher à entamer la conversation : « Il fait bien beau aujourd’hui, M. Léon, est-ce que vous n’irez pas promener un peu : vous restez toujours enfermé chez vous, cela doit nuire à votre santé. » Le jeune homme souriait avec bienveillance aux avances amicales de Victor, lui répondait en peu de mots, et remontait chez lui, ou quittait sa croisée. Il était évident que ce jeune homme tenait à ne pas se lier avec aucun de ses voisins.
Plus d’une fois, à une heure avancée dans la nuit, Victor avait vu la chambre de Léon encore éclairée, et, à travers les légers rideaux de mousseline, il avait cru l’apercevoir assis à sa table et travaillant. Il n’en fallait pas davantage pour porter au plus haut degré l’intérêt que lui inspirait déjà le jeune homme studieux et rangé ; d’autant plus que rien dans sa personne ne respirait l’aisance : « C’est un pauvre diable, s’était dit Victor, qui se tue le corps et l’âme à travailler, et qui ne m’a pas l’air du tout bien calé4, faudra voir ça un peu… » Mais comment arriver à la découverte de ce qui l’intéressait si fort ; car, malgré son éducation imparfaite, il sentait bien qu’il y aurait eu de la bassesse à commettre une indiscrétion, et qu’il pouvait, par une imprudente curiosité, se rendre importun à celui qui en était l’objet, et peut-être même lui causer une peine réelle ; il se creusait donc inutilement l’esprit et désespérait d’arriver à son but ; les circonstances le servirent mieux que ses petits calculs.
“Un de ces jeunes amans de la gloire”
Un jour vint où le jeune homme ne sortit pas ; chacun s’en étonna ; puis, un autre jour suivit celui-ci, et un troisième encore ; depuis trois jours, on n’avait pas vu Léon, et le cœur de ces bonnes gens s’émouvait d’inquiétude pour le pauvre isolé. Victor, plus que les autres, en éprouvait une véritable peine ; il avait pressenti que quelque grand malheur accablait son voisin. Le soir du troisième jour venu, il résolut de mettre un terme à son incertitude : quand toutes les lumières furent éteintes aux divers étages de la maison, il prit sa chandelle et se dirigea vers son voisin. Il frappe… Point de réponse… Il frappe encore… Même silence… Il regarde… La clé n’est point sur la porte… Quelque chose dit à Victor qu’il ne doit point s’arrêter à la vaine crainte d’affliger le jeune homme ; il pousse fortement la porte, dont la serrure, vieille et usée, cède à ses premiers efforts… Il s’avance dans l’intérieur de la chambre… Un spectacle affreux s’offre à sa vue… Léon est étendu sans connaissance sur son mauvais grabat, et, à la pâleur de ses joues, à la froideur de tout son corps, il est facile de voir qu’il est depuis long-temps dans ce dangereux état. Victor sent qu’ici sa bonne volonté est impuissante ; il rentre précipitamment chez lui, et avertit son père de ce qu’il vient de faire et de voir. Celui-ci n’hésite pas ; en deux minutes, il est habillé, et bientôt un médecin, amené par lui, vient donner des soins au pauvre jeune homme. À la première inspection, il déclare que le malade est tombé de faiblesse et d’inanition.….5 D’inanition ! s’écrie Victor, lorsqu’il n’avait qu’à parler pour nous voir tous venir à son secours : ce que c’est que l’orgueil !… Après une heure de soins empressés, Léon revient à lui ; mais il divague ; il a le délire… Et des mots, entrecoupés et sans suite, se pressent sur ses lèvres. — « La gloire.… Vain songe ! Mourir si jeune… Sans avoir rien fait… Repoussé par tout6… Pas un éditeur… Une œuvre si complète… Le fruit de tant de veilles.… Périr avec moi… Sans avoir vu le jour… Et pour être placée au rang des plus belles,… il ne manque peut-être à mon œuvre, que de pouvoir être appréciée du public… » Tels sont les lambeaux de phrases que prononce le jeune homme. — Victor a tout compris. — Léon est un de ces jeunes amans de la gloire, qui la recherchent à tout prix ; c’est un auteur, un poète peut-être, qui meurt de faim parce qu’il n’a pas un nom illustre, et qu’aucun éditeur ne veut se donner la peine de lire son œuvre, ni courir le risque de l’éditer…
Le lendemain, le malade va mieux ; on peut espérer son retour à la santé ; mais la convalescence sera longue et pénible… Cependant, Victor rentre toujours une heure plus tard, et part pour son atelier une heure plutôt ; la famille remarque avec plaisir cet accroissement d’activité et croit que son enfant songe à augmenter ses petits profits.
“Un grand Monsieur noir”
Les jours ont fait place aux semaines, et les semaines aux mois ; Léon ne s’est pas encore levé de son lit : le jour est enfin venu, où il va lui être permis de se remettre peu à peu à ses travaux ; ses bons voisins sont venus à son secours, et il ne manque de rien… Ils sont tous présens, lorsqu’appuyé sur le bras de madame Duty, il se lève, et se dirige vers son bureau.… Il s’assied, et remue des papiers entassés les uns sur les autres ; il cherche avec agitation.…. Enfin, lorsqu’il semble avoir acquis la preuve que l’objet dont il s’inquiète est disparu ; il penche sa tête sur sa poitrine, et des pleurs rares et brûlans coulent le long de ses joues ; on s’empresse autour de lui… On le questionne… Il se lève enfin, et d’une voix forte, quoique pleine de larmes, il s’écrie : J’avais composé un ouvrage, c’était tout mon espoir ; pendant ma maladie, mon manuscrit est disparu ; on me l’a volé sans doute… À ces mots, la porte, entr’ouverte depuis quelques instans, s’ouvre tout-à-coup7 ; c’est Victor : — On ne vous a pas volé votre manuscrit, M. Léon, parce qu’il n’y a pas de voleur parmi des braves gens comme nous ; mais on vous l’a imprimé, et le voilà, ajoute-t-il en lui remettant un volume tout fraîchement broché. — Imprimé ! Mon ouvrage imprimé ! — Et tiré à 1,500 exemplaires, M. Léon. — Et quel est l’ange consolateur à qui je dois un tel bienfait. — N’y a pas d’ange là-dedans, M. Léon, c’est votre serviteur. — Quoi ! il serait possible ! Oh ! viens, Victor, bon et généreux enfant, viens que je t’embrasse comme mon meilleur ami, comme mon frère ! je te dois deux fois la vie ; car je te devrai peut-être la célébrité. — Cela se pourrait, M. Léon. — Que veux-tu dire ? — C’est qu’il y a un grand Monsieur noir, qui vient quelquefois à l’imprimerie, et qui dit comme ça que c’est fièrement beau ce qu’il y a là-dedans. — Et pendant que Léon considère son volume, l’ouvre à toutes les pages, semble en contemplation devant lui, et recueilli dans un bonheur inexprimable, chacun de questionner Victor… C’est donc pour ça que tu travailles par jour deux heures de plus depuis deux mois. — Oui, papa ; mais je ne suis pas seul, et quand je leur ai conté la chose, les autres ont voulu s’y mettre aussi, et tous les ouvriers y ont travaillé. — Ah ! vous êtes tous de braves gens ; viens, mon Victor, que je t’embrasse. — Et les imprimeurs ? — Ont travaillé une heure de plus aussi. — Mais le papier ? — Je gagne 10 sous par jour, je les ai mis ; on a fait, pour ce qui manquait, une collecte dans l’atelier, et voilà. — C’est donc bien beau ce livre-là. — Je ne sais pas, moi ; mais d’après ce qu’a dit le grand Monsieur noir, dont je vous parlais tout à l’heure, et qui paraît s’y connaître, faut croire que c’est très-beau. — Qu’est-ce que c’est que ce grand Monsieur noir que tu nous dis ? — Je ne sais pas non plus ; mais il m’a demandé l’adresse de M. Léon, et je la lui ai donnée ; peut-être qu’il viendra ; mais on entre ; tenez, c’est justement lui… Vous voulez parler à M. Léon ? Le voilà, Monsieur. — Il ne fallut rien moins que ces paroles pour tirer Léon de l’extase où il était plongé. — Monsieur, j’ai parcouru votre ouvrage à l’imprimerie ; il me paraît aussi bien pensé que bien écrit ; je venais vous proposer de m’en rendre l’éditeur, pour la première et la deuxième édition, moyennant 6,000 francs. Léon accepta avec empressement… Quand l’éditeur fut sorti : Mon jeune protecteur, dit-il à Victor, comment te témoigner ma reconnaissance ? Je sens bien que je ne puis ni ne dois te parler de récompense… — Eh ! vous avez bien raison, M. Léon, je ne vends pas mes services à mes amis, je les donne, et si vous voulez bien me regarder comme votre ami, ce sera ma meilleure récompense. — Oh ! oui, mon ami, tu le seras, et toujours, toi qui m’as ouvert le chemin de la gloire.
Grâce à ce premier ouvrage qui l’a placé au rang qui lui appartenait parmi les écrivains, Léon est devenu un homme célèbre ; il est riche aujourd’hui ; son ami Victor a acheté, avec la bourse de Léon, un brevet d’imprimeur, et il exerce à son compte.
Il faut voir comme les éditions des œuvres de M. Léon, imprimées chez Victor Dutuy, sont correctes, élégantes et soignées. Il n’y en a pas qui puisse lutter avec elles pour la beauté des caractères et la netteté du tirage. Victor Dutuy y met tant de zèle, de goût et d’exactitude, qu’il est facile de voir qu’il travaille.…. comme pour un ami.….
Que conclure de tout ce qui précède ?… Que, dans toute[s] les classes de la société, ou peut rencontrer des individus qui en sont l’honneur, et qui le seraient encore des classes les plus élevées ; que jamais la persévérance, le travail et la bonne conduite, ne demeurent sans récompense. Voyez plutôt : Léon était sage autant que travailleur ; il inspira de l’intérêt à tous ses voisins, et cet intérêt ne fut pas stérile puisqu’au jour du besoin tous s’empressèrent autour de lui. Mais la générosité de caractère, l’humanité de Victor, portèrent aussi leurs fruits : Léon, d’abord protégé par lui, devint à son tour son protecteur, et lui rendit en reconnaissance ce qu’il en avait reçu en humanité. Gardez-vous pourtant de croire que toujours une bonne action trouve ainsi sa récompense. Non : l’on rencontre beaucoup d’ingrats, qui, loin d’aimer leurs bienfaiteurs, semblent rougir du service qu’on leur a rendu, et pour qui la reconnaissance est un pesant fardeau. Est-ce une raison pour cesser d’être bienfaisant ? Non certes ; l’homme généreux fait le bien pour le plaisir de le faire, pour le bienfait lui-même ; il ne compte sur la reconnaissance de personne ; sa récompense, c’est l’estime des honnêtes gens, la satisfaction, dont l’accomplissement d’une bonne action remplit toujours notre cœur, et enfin la certitude, qu’à défaut même de l’estime des hommes et de la gratitude des obligés, Dieu, qui n’oublie jamais, lui tiendra compte de ses œuvres.
ARTHUR DE FILLIÈRE.
Extrait de : « The Printer Devil. (Le diable de l’imprimerie.) », dans Les Enfans peints par eux-mêmes, sujets de composition donnés à ses élèves par Alexandre Saillet, maître de pension. Paris, Desesserts, éditeur, passage des Panoramas, galerie Feydeau, 13, 1841, p. 164-170.
- En anglais, la bonne orthographe est printer’s devil. Voir le Wikipedia anglais. ↩︎
- Acte ou parole. Penser à trait de générosité ou trait de génie. ↩︎
- Bien que cette orthographe ait été rectifiée par l’Académie en 1835, ce texte l’écrit encore « à l’ancienne », de même que, plus loin, amans, long-temps, plutôt ou très-beau. ↩︎
- Bien établi, riche. ↩︎
- J’ai laissé le nombre de points de suspension d’origine. ↩︎
- Coquille : partout. ↩︎
- Fautif, même à l’époque : tout à coup. ↩︎