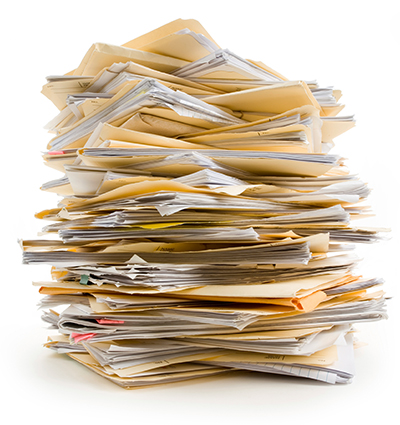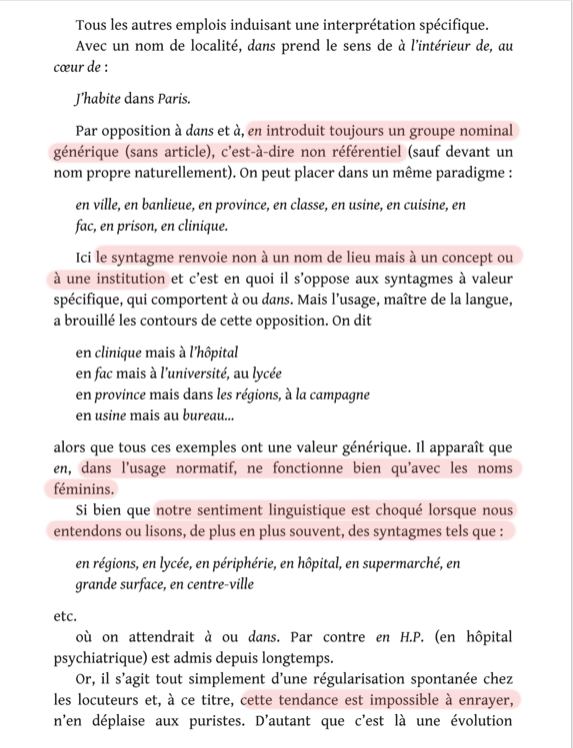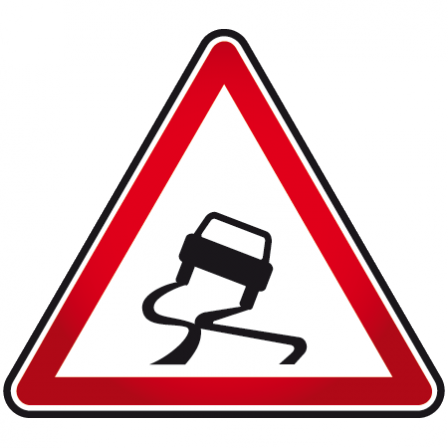Lors d’un discours, pour introduire ce qui suit, doit-on écrire je dirai ou je dirais ? À la question sur cette indécision modale (futur ou conditionnel), posée sur divers forums, certains ont répondu avec assurance que le conditionnel s’imposait.
Cela me surprend, car j’ai souvenir d’avoir rencontré dans mes lectures nombre d’emplois du futur. Et, en effet, après une rapide recherche dans Le Grand Robert, je constate que je dirai s’impose en nombre d’occurrences face à je dirais (53/28), de même que j’ajouterai devant j’ajouterais (14/1). Le résultat est similaire avec les textes du site de l’Académie française : j’ajouterai est nettement majoritaire (102/22) ; je dirai l’est plus légèrement (216/177).
Étrangement, les grammaires que j’ai consultées sont quasi muettes sur le sujet, mais on trouve aisément des exemples au futur dans les dictionnaires : J’ajouterai une remarque (Académie) ; J’ajouterai qu’il y a une autre raison de choisir cette solution (Girodet) ; J’ajouterai, si vous le permettez, que… ; Pour être plus précis, je dirai que… ; Avec votre permission, je dirai que c’est un crétin (trois exemples du Grand Robert).
L’argument principal employé pour défendre je dirais ou j’ajouterais est qu’il s’agirait d’un conditionnel « de politesse, d’atténuation ou de réserve » : on sous-entendrait « si je devais donner mon avis ».
C’est oublier que le futur peut, lui aussi, avoir valeur d’atténuation, comme le mentionne Grevisse au § 887, b, 2° :
On rencontre d’autres formes au futur, telles que Le dirai-je ? Dirai-je que… Oserai-je le dire ? Je vous dirai tout franc que… J’observerai ; je vous ferai observer, etc.
Véritable marquage d’un fait à venir quand il annonce en introduction le contenu du discours – Je dirai les hauts faits de Roland (Académie) ; Je dirai les exploits de ton règne paisible (Boileau, Épîtres, I) – ou sa conclusion (Pour me résumer, je dirai que…), le futur simple devient une simple transition élégante en cours d’élocution :
- […] je dirai, définissant ce dictionnaire, qu’il embrasse et combine l’usage présent de la langue et son usage passé, afin de donner à l’usage présent toute la plénitude et la sûreté qu’il comporte (Littré, Dict., Préface, II).
- J’ajouterai que, vendredi, samedi dernier au plus tard, il a, dans la même caisse, opéré un second prélèvement, de cinquante francs, cette fois (G. Duhamel, Salavin, Journal).
- […] je dirai qu’il [Delacroix] est mort à la manière des chats ou des bêtes sauvages qui cherchent une tanière secrète pour abriter les dernières convulsions de leur vie (Baudelaire, Curiosités esthétiques, XIV).
C’est une variante polie du présent de l’indicatif (Et pour plus de clarté, j’ajoute que…) ou de l’impératif (Parlons de…).
Nous avons donc parfois le choix entre le futur et le conditionnel pour atténuer notre discours, mais quand ?
Écartons les cas simples (exemples tirés du Robert ou du Grevisse, sauf mention contraire).
Une condition est formulée à l’imparfait :
- Si j’osais, je dirais… (ce qui, au présent, devient bien : si j’ose, je dirai).
- Brava ! Brava ! ça c’est très bien, je dirais comme vous que c’est chic, que c’est crâne, si je n’étais pas d’un autre temps […], s’écria la vieille dame […] pour remercier Gilberte d’être venue sans se laisser intimider par le temps (Proust, Rech., t. I).
Une condition est formulée au présent, ce qui entraîne le futur :
- Si j’exprime ce qui reste implicite dans la définition qu’en donnent les dictionnaires, je dirai qu’un caractère est un signe conventionnel, unicolore, plan, qui représente une information couramment lisible par l’homme. […] (La Recherche, n° 126, oct. 1981).
- […] je n’ose dire que je le regrette, mais, si je le puis, j’ajouterai tout de suite que c’est la seule générosité qui vous aura manqué (Camille Jullian, discours de réception).
- […] comme il est inutile d’en disputer ici, je dirai, si l’on veut, que la vie des mortels a deux pôles, la faim et l’amour (France, La Rôtisserie de la reine Pédauque).
Des verbes au futur se succèdent :
[…] Je n’entrerai point ici dans le détail des couleurs du plumage ; je dirai seulement qu’elles ont beaucoup moins d’éclat dans la femelle que dans le mâle […] (Buffon, Hist. nat., Des oiseaux, Le faisan).
L’annonce d’un simple ajout reste au futur :
- […] notre esprit est si curieusement bâti que le fragment d’expérience qu’il recueille ne lui apparaît jamais pour commencer comme un fragment, mais bien comme un tout ; j’ajouterai que chaque observation si mince soit-elle, nous est donnée par là comme une observation intégrale et qu’il ne serait même pas exact de dire que nous supposons les expériences à venir identiques aux premières (J. Paulhan, Entretien sur des faits divers, I).
- Elle est épatante, et je dirai plus, charmante (Camus, L’Étranger, VI).
- Vous pardonnerez donc, je l’espère, à l’émotion qui me suffoque. Je dirai plus : certain que vous la partagez, je ne tenterai pas de m’y soustraire (Courteline, Messieurs les ronds-de-cuir, 6e tableau, II).
- Presque tout ce que déclare Freud sur ce qu’il appelle le complexe d’Œdipe est absurde et je dirai surtout inexact (G. Duhamel, Manuel du protestataire).
- […] rarement [les femmes] se pardonnent-elles l’avantage de la beauté. Et je dirai en passant que l’offense la plus irrémissible parmi ce sexe, c’est quand l’une d’elles en défait une autre en pleine assemblée […] (La Fontaine, Les Amours de Psyché).
- J’ajouterai encore que, si un exemple est nécessaire pour faire entendre une pensée, ce n’est pas par la pensée qu’il faut commencer comme on fait communément, c’est par l’exemple (Condillac, L’Art d’écrire, IV, 2).
- Je n’ai pas inventé l’attitude, il l’avait telle. J’ajouterai enfin que sa taille était élancée, ses épaules larges et sa voix forte d’une assurance que lui donnait la conscience de son invincible beauté (Jean Genet, Miracle de la rose).
Le futur peut être assorti d’une introduction ou d’une justification :
- […] pour parler la langue de Rivarol ou de Chamfort, […] je dirai… (Sainte-Beuve, P.-J. Proudhon, Sa vie et sa correspondance).
- Empruntant un mot à Stendhal […], je dirai que… (Valéry, Variété IV).
- Pour ne rien paraître lui ôter, je dirai seulement… (Sainte-Beuve, Causeries du lundi, 17 mars 1851).
- Comme je n’ai pas l’habitude de mâcher les mots, je dirai… (A. Hermant, Chronique de Lancelot du « Temps », t. II).
- Au risque de schématiser à l’extrême, je dirai qu’il… (Jean Ziegler, Main basse sur l’Afrique).
- J’ajouterai, pour être franc… (Villiers de L’Isle-Adam, Tribulat Bonhomet).
- J’ajouterai, pour l’illustration de ce passage… (Voltaire, Dict. philosophique, Enfer).
(On notera au passage que la négation de je dirai peut se transformer en prétérition : je ne dirai pas… mais c’est un autre sujet.)
Opposition/concession
C’est quand le terme introduit une opposition ou une concession que le choix entre futur et conditionnel est le plus pertinent :
- Il y a ici un problème et je dirai même un mystère extrêmement grave. […] (Ch. Péguy, La République…).
- Mais son pessimisme gardait quelque chose de bien portant, je dirai même de parfois jovial (Jules Romains, discours de réception).
- […] le mot est prononcé mais, chaque fois, il est articulé avec tendresse, avec amitié, je dirais même avec respect (Félicien Marceau, discours de réception).
- Si franc qu’on le suppose, le rire cache une arrière-pensée d’entente, je dirais presque de complicité […] (H. Bergson, Le Rire, I).
Le conditionnel est aussi favorisé par bien, volontiers, peut-être, cependant, personnellement, pour ma part…
- [La poésie] se sert des mots comme la prose. Mais elle ne s’en sert pas de la même manière ; et même elle ne s’en sert pas du tout ; je dirais plutôt qu’elle les sert. Les poètes sont des hommes qui refusent d’utiliser le langage (Sartre, Situations II).
- C’est vrai, mais je dirais qu’un écrivain doit cultiver les siennes (ses souffrances) et appuyer sur les points névralgiques. C’est quand il se fait crier de douleur, quand il touche aux cordes sensibles, qu’il libère le meilleur de son talent […] (A. Maurois, Le Cercle de famille, IX).
- Je dirais volontiers, généralisant un peu ma pensée, que tous les exemples de débridement sont funestes (Gide, Feuillets, in Journal 1889-1939).
- Ces tronçons d’arbres ont deux cent trente millions d’années et ont été fossilisés, je dirais pétrifiés, à l’époque glaciaire (J. Green, Journal, La Terre est si belle, 18 juin 1978).
Le futur suffit généralement quand on enchaîne dans son propre discours. On emploie plutôt le conditionnel quand on ménage autrui, quand on suggère un ajout, une précision, une correction et bien sûr – comment dirais-je ? – quand on veut exprimer une hésitation, réelle ou rhétorique.