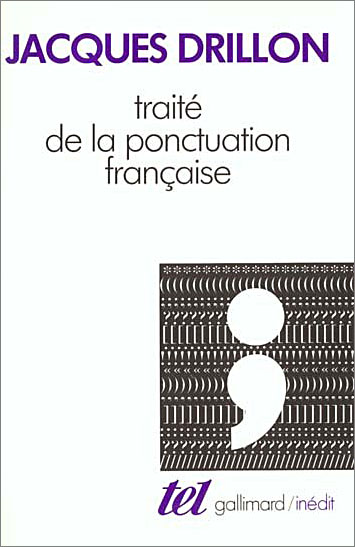
J’ai profité du premier confinement pour lire in extenso le Traité de la ponctuation française, de Jacques Drillon (Gallimard, 1991) – un vieux projet. Un ouvrage évidemment passionnant et instructif.
Dans la première partie, outre l’histoire de la ponctuation, on apprend notamment que, même dans les éditions critiques (Pléiade), la ponctuation des auteurs classiques (avant le xixe s.) est modifiée, ce qui n’est pas sans poser problème.
Dans la seconde partie, j’ai constaté avec plaisir que la plupart des nombreuses règles m’étaient acquises par la pratique de la correction et la fréquentation des écrivains.
Une règle, cependant, a retenu mon attention, car je la cherchais inconsciemment. Jamais de virgule entre le sujet et le verbe, dit le code typographique1. Il y a tout de même des exceptions, que j’ai souvent rencontrées au cours de mes lectures.
« On met une virgule pour séparer les divers sujets d’un verbe (s’ils ne sont pas reliés, répétons-le, par une conjonction). Le dernier sujet est lui-même séparé du verbe par une virgule […] on peut considérer que la dernière virgule, immédiatement avant le verbe, confère à tous les sujets une valeur égale. »
« La sottise, l’erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps » — Baudelaire
« Les arbres, les eaux, les revers des fossés, les champs mûrissants, flamboient sous le resplendissement mystérieux de l’heure de Saturne » — Claudel
Cela fonctionne aussi après la dernière épithète d’un complément ou d’un sujet :
« Tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêt aromatique » — Baudelaire
… ou après plusieurs adverbes :
« L’infirmier leur massait longuement, puissamment, les muscles des jambes […]» — Michel Mouton
Inversement, « dans une laisse de sujets dont les deux derniers sont liés par “et”, on ne met pas de virgule entre le dernier et le verbe » :
« Trop de diamants, d’or et de bonheur rayonnent aujourd’hui sur les verres de ce miroir où Monte-Cristo regarde Dantès » – Dumas
Grevisse donne la même règle au § 128, avec des exemples pris chez Mauriac et Saint-Exupéry. Parmi les autres cas où il admet la virgule « interdite », il donne celui-ci :
Lorsque le sujet a une certaine longueur, la pause nécessaire dans l’oral est parfois rendue par une virgule dans l’écrit (mais on préfère aujourd’hui une ponctuation plus logique, qui ne sépare pas le sujet et le verbe) : La foudre que le ciel eût lancée contre moi, m’aurait causé moins d’épouvante (Chat., Mém., I, ii, 8). — Quand la personne dont nous sommes accompagnés, nous est supérieure par le rang et la qualité (Littré, art. accompagné). — Les soins à donner aux deux nourrissons qui lui sont confiés par l’Assistance, l’empêchent de garder le lit (Gide, Journal, 27 janv. 1931). — Le passé simple et la troisième personne du Roman, ne sont rien d’autre que ce geste fatal par lequel l’écrivain montre du doigt le masque qu’il porte (Barthes, Degré zéro de l’écriture, I, 3). — La réponse que je donnai à l’enquête par Voyage en Grèce (revue touristique de propagande) et que l’on trouvera en tête de la seconde partie de ce recueil, sert donc […] de charnière entre les deux parties (Queneau, Voyage en Grèce, p. 11).
Je n’entre pas plus dans les détails – la virgule occupe chez Drillon plus de cent pages – et vous renvoie aux pages 165 à 176 pour ce point précis. Drillon précise que « le Code typographique » (celui de la Fédération CGC de la communication, 1989) et « certains grammairiens » désapprouvent ces exceptions. Pour ma part, je trouve là la confirmation qui me manquait. Je n’ajouterai que cette citation :
« Il arrive à la virgule d’être “facultative”. C’est alors que l’auteur se montre, et par quoi il se distingue d’un autre » (p. 150).
Article mis à jour le 16 septembre 2024.
- Sur l’histoire de ce « tabou », voir Jacques Dürrenmatt, « La virgule entre sujet et verbe : petite histoire d’un emploi oublié », L’Information grammaticale, n° 102, juin 2004, p. 31-34. ↩︎